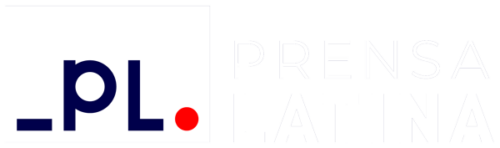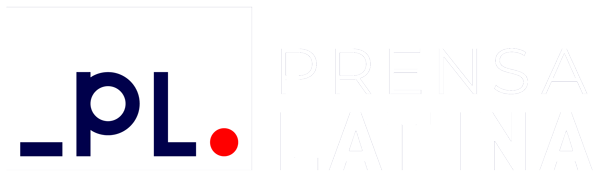Par Antonio Cuesta*
Par Antonio Cuesta*
Ankara, 21 décembre (Prensa Latina) La victoire de Recep Tayyip Erdogan aux élections présidentielles turques a été davantage qu’une réélection. Cette victoire marque le début d’un nouveau système de gouvernement, différent de celui qui avait cours depuis la fondation de la République.
Lorsque, en avril 2017, les citoyens turcs ont approuvé à une courte majorité la réforme constitutionnelle proposée par le parti au gouvernement, l’AKP (le Parti Justice et Développement, un parti islamiste et conservateur), peu de personnes pouvaient prévoir que ce système présidentialiste serait mis en place aussi rapidement et que l’inspirateur de la réforme, le chef de l’APK, se trouverait alors aux commandes.
Car, en principe, les partis politiques, tout comme les citoyens eux-mêmes, pensaient que les changements profonds que le nouveau système allait instaurer n’entreraient en vigueur que lorsque le pays élirait un nouveau président, et la date fixée pour cette élection était le 3 novembre 2019.
Cependant, le 18 avril 2018, Erdogan annonça que les élections législatives et présidentielle auraient lieu deux mois plus tard, c’est-à-dire avant que n’apparaissent les effets de la récession économique et la perte rapide de soutien envers le gouvernement et son allié d’extrême droite, le MPH (Parti d’Action Nationaliste).
Le vote du 24 juin fut certainement l’épreuve la plus compliquée à laquelle Erdogan a dû faire face depuis les 15 années qu’il est au pouvoir, en tant que premier ministre de 2003 à 2014, d’abord, puis en tant que président, à partir de cette date, car, lors de ces élections, il perdit 20 pour cent de son soutien électoral et seuls les résultats inespérés du MPH lui permirent d’atteindre les 52 pour cent des suffrages qui lui donnèrent la victoire au premier tour.
La nouvelle législature – pour cinq années, au lieu de quatre, précédemment- va permettre à Erdogan de rester président jusqu’à la date emblématique de 2023 qui marque le 100ème anniversaire de la création de la République de Turquie.
Toutefois, la mise en place des changements opérés par le nouveau système présidentialiste a mis un terme à cette démocratie quasi-centenaire dans laquelle le chef de l’État avait des attributions plus protocolaires qu’effectives et où le parlement fixait les budgets du gouvernement.
Le modèle actuel abandonne des dispositions qui ont été la règle de 1924 à 2017 et qui caractérisaient le modèle turc, entre autres la place du premier ministre ou ses attributions lorsqu’il fallait nommer les membres de son cabinet, et, aux dires de nombreux observateurs, la nouvelle réforme marque un changement radical comparable à celui qui mis fin au sultanat en 1923.
Le 9 juillet dernier, Erdogan a pris la charge d’un poste qui, si l’on recense tous les pouvoirs qui lui sont attribués, fait de lui le gouvernant le plus puissant de l’histoire de la Turquie puisqu’il peut nommer les ministres et la majorité des membres des principaux tribunaux et organes judiciaires du pays, y compris ceux du Conseil Constitutionnel, de la Cour Suprême et du Conseil d’État.
En même temps, l’Assemblée Nationale a perdu tout pouvoir de contrôle sur le gouvernement qui n’a plus à répondre à ses décisions. Sans oublier que, dorénavant, toute possibilité de proposer une motion de censure est exclue.
En outre, alors que le rôle du Parlement se limite seulement à réviser les lois émises par le président, ce dernier peut avoir recours à la Cour Constitutionnelle pour les lois, les règlements ou les dispositions, quand il le juge nécessaire.
Mais, si cette nouvelle présidence de l’exécutif est arrivée avec un an d’avance, ce décalage est principalement dû à l’ombre d’une crise économique, causée par les tensions entre la Turquie et les États-Unis, qui fit craindre le pire lorsque, le 14 août, le cours de la devise nationale s’effondra de plus de 10 pour cent et que sept lires turques n’achetaient plus qu’un seul dollar.
La réaction du gouvernement ne s’est pas faite attendre et, le 20 septembre, il a annoncé un Nouveau Programme Économique (YEP, en turc) pour encourager les investissements étrangers et dissiper ainsi les doutes qui planaient sur un début de crise économique en présentant cette dernière comme une simple turbulence passagère.
Le ministre de l’Économie et des Finances, Berat Albayrak, tout en considérant que les problèmes économiques dont souffrait le pays n’étaient dus qu’à des “facteurs externes négatifs”, s’est engagé à remettre le pays sur pied grâce à un plan de trois ans qui transformera en profondeur l’économie.
Mais tous ces calculs économiques n’ont pas empêché de revoir le bilan à la baisse et, même après plusieurs mois, les prévisions restent trop optimistes si l’on tient compte du fait que, en cette fin d’année 2018, l’inflation a dépassé de 1 point les 20,8 pour cent prévus et que le chômage a augmenté pendant sept mois consécutifs bien au-delà des estimations espérées.
La croissance économique tant désirée s’essouffle également et les analyses du troisième trimestre de cette année font apparaitre le moins bon résultat de ces dernières années, bien que l’exportation de biens et de services ait augmenté de 13,6 pour cent et que les importations aient décru de 16,7 pour cent.
Or, si les premiers mois de 2018 ont été marqués par le progrès électoral du parti au gouvernement et par les changements politiques, conséquence du suffrage obtenu dans les urnes, l’économie n’en a pas moins conditionné l’agenda de la politique et celui des familles pendant la seconde partie de l’année.
Parmi les pays émergents, l’inflation que connait la Turquie ne peut être comparée qu’à celle de l’Argentine, qui est déjà passée sous contrôle du Fond Monétaire International, et où, comme le montre un rapport de l’Institut de la Statistique, le pouvoir d’achat des habitants est en baisse, ce qui entraine un effondrement de l’indice de confiance économique.
En Turquie, à la fin du mois de septembre, cet indice se situait au niveau le plus bas de ces dix dernières années avec une perte de 15,4 pour cent en un seul mois pour se situer à 71 points, c’est-à-dire bien en dessous de 100, qui marque l’indice d’équilibre, tout chiffre supérieur indiquant une économie en bonne santé et tout chiffre inférieur une économie en crise.
Si, comme le signale ce rapport, l’indice de confiance “ est l’un des signes annonçant une possible croissance économique”, la conclusion est que les citoyens ont eu raison d’anticiper le fort ralentissement qui, quelques mois plus tard, a été reflété par les nouveaux relevés trimestriels du Produit Interne Brut (PIB).
Les conditions économiques et les conditions de vie sont en train d’empirer dans une société qui, pendant des dizaines d’années, a connu une répartition de la richesse parmi les plus injustes au monde. Dans la situation actuelle, elle a peu d’espoir que les choses s’améliorent.
*Correspondant de Prensa Latina en Turquie.
peo/arb/ac