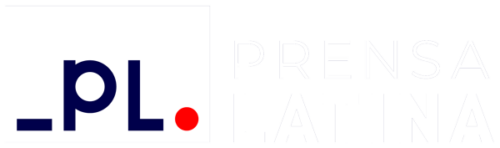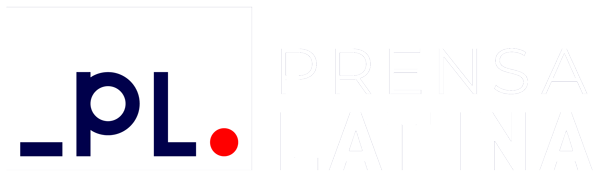Marcelo Colussi*, collaborateur de Prensa Latina
(« Si le vote pouvait changer quelque chose, il serait déjà interdit ».
Cela fait presque quatre décennies que le pays a repris cette tradition de vote tous les quatre ans, que l’on appelle « démocratie ». Au cours de cette période, onze présidents se sont succédé (neuf sont arrivés par vote populaire et deux à la suite de règlements administratifs), et la masse électorale et la population en général n’ont trouvé de différence avec aucun d’entre eux.
Comme toujours, les décisions essentielles n’ont pas été prises au sein de la maison du gouvernement, mais par des véritables facteurs de pouvoir, qui continuent d’être les hautes sphères du monde des affaires, avec quelques groupes économiques au premier plan (qui financent les campagnes des partis politiques), et l’ambassade des États-Unis.
Le processus électoral a été hyper-judiciarisé via des dénonciations continues d’un côté et de l’autre. Il n’y a aucune proposition concrète d’aucun parti que les gens prennent au sérieux, et les problèmes structurels du pays se poursuivent comme d’habitude, voire s’aggravent : pauvreté extrême, exclusion sociale, racisme, patriarcat, violence citoyenne, migration massive vers les États-Unis comme moyen de sortir de la crise. Rien n’indique que ces élections changeront quoi que ce soit. Comme cela a été dit à plusieurs reprises, nous sommes confrontés à « plus de la même chose ». Ou, ce qui est pire : la même chose avec plus de la même chose. Il semble qu’à chaque nouvelle administration, le camp populaire se sente de plus en plus déçu.
En réalité, ce dont il s’agit, c’est d’un spectacle où la « démocratie » n’est qu’un vain mot. Le Tribunal Suprême Electoral s’acharne à aider la droite traditionnelle contre la gauche et contre les nouvelles options de droite (Carlos Pineda), or contrairement au scénario déjà écrit par ces pouvoirs, perdant ainsi sa prétendue objectivité. Tout reste pareil et rien n’a l’air changer vers le 25 juin.
La population votante désespère. Au cours des quelque quatre décennies qui ont suivi le retour de la démocratie, aucun des gouvernements successifs n’a connu de véritables changements. Il n’y en a pas non plus à l’horizon. Au vu des campagnes électorales, largement axées sur des banalités superficielles, il est très probable que le taux de participation sera faible, car les gens sont déjà fatigués de cette situation qui est plutôt dérisoire.
Il n’y a pas d’espoir de changement. Les partis de droite n’offrent rien de nouveau, seulement des slogans creux et des cadeaux occasionnels (une casquette, un T-shirt), et encore moins des programmes concrets qui correspondent à la réalité.
En bref, pour les électeurs, la victoire de l’un ou l’autre candidat n’a aucune importance, car aucun changement n’est attendu. De son côté, la gauche est pratiquement inexistante. Quelqu’un gagnera et deviendra le prochain président, mais sûrement sans grande légitimité populaire. Tout indique que personne ne gagnera au premier tour, il faudra donc attendre le second tour en août. Cela veut dire que le président n’est qu’un administrateur, un gestionnaire des grandes affaires du grand capital, et que la masse des électeurs le regarde avec dédain. Légiférer, c’est donner sa bénédiction à ces secteurs dominants, c’est formuler des lois à leur gré.
De son côté, la gauche est très fragmentée, sans approche profonde du changement, sans direction. Le seul parti de gauche qui pouvait se battre pour la présidence, le Mouvement de Libération des Peuples (parti paysan d’origine maya, très nombreux dans les départements du pays), a été stoppé par la droite au pouvoir par un tour de passe-passe juridique qui l’a freiné.
Les petites formations de gauche en lice ont peu de chance de s’en sortir. Ils pourront à peine gagner quelques sièges au parlement et, éventuellement, quelques mairies. Aucun changement structurel profond ne peut être attendu de leurs actions. Après la signature des accords de paix en 1996, qui ont ouvert quelques espoirs de changement en mettant fin au sanglant conflit armé interne qui a laissé des séquelles encore persistantes aujourd’hui, la gauche est restée très affaiblie et, ces dernières années, elle n’a toujours pas été en mesure de réagir de manière adéquate.
Les perspectives réelles de sortie de cette immense crise multiforme que traverse le pays ne sont pas vraiment en vue. La situation continue de se dégrader jour après jour. Sur le plan macroéconomique, le Guatemala ne va pas mal. Son économie est florissante, parmi les dix plus grandes d’Amérique latine, mais elle est très inégalement répartie. Un petit groupe a tout, et une grande majorité n’a rien. Les problèmes abondent. À la pauvreté historique (60 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté) s’ajoute une vague irrépressible de violence criminelle, produit de cette misère généralisée et de la culture de la violence laissée par la guerre passée. Aussi pathétique que cela puisse paraître, c’est une dure réalité : on peut être tué pour avoir volé un téléphone portable. La population est donc extrêmement effrayée, ligotée, condamnée à se rendre de son domicile à son travail ou à son école et vice-versa, dans la peur. À cela s’ajoutent d’autres problèmes énormes, structurels et historiques, tels que le racisme à l’égard des peuples indigènes (la population d’origine maya, qui représente la moitié du pays) et le machisme patriarcal. Tout cela n’est pas considéré comme quelque chose qu’un gouvernement puisse affronter avec une réelle possibilité, ou volonté, de succès.
Les perspectives d’avenir sont plutôt sombres : une nouvelle guerre civile à l’horizon ? Tout à fait plausible.
jcc/mc
*Politologue argentin, professeur d’université et chercheur en sciences sociales, résidant au Guatemala.
(Extrait de Firmas Selectas)